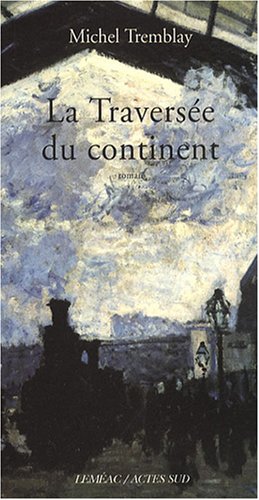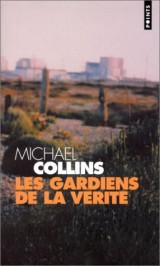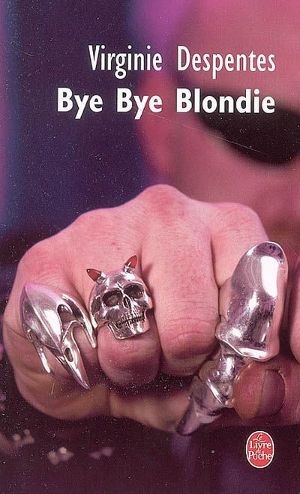La Traversée du continent – Michel Tremblay
La Traversée du continent – Michel Tremblay
« J’voulais juste faire un courant d’air. Y fait trop chaud, ici-dedans. »
Résignée, Rhéauna revient à sa place.
Une chose insolite se produit alors. Aussitôt que Régina s’installe au banc du piano, avant même qu’elle ne soulève le couvercle qui protège le clavier, un changement notable s’opère chez elle, quelque chose de subtil et de radical qui se perçoit même si Réhauna ne la voit que de dos. Ses gestes deviennent plus coulants, sa main caresse le bois verni, son corps, de raide qu’il était, prend une étrange molesse, et c’est avec une fébrilité très palpable qu’elle ouvre le cahier de musique qui se trouve devant elle. Elle le lisse lui aussi du plat de la main, mais son mouvement est beaucoup plus doux que lorsqu’elle chassait les miettes inexistantes de sa longue jupe, un peu plus tôt.
Elle se tourne vers sa nièce.
« C’est du Shubert. Connais-tu ça, Shubert ? »
Elle prononce le nom à l’anglaise, en faisant sonner le t de la fin, comme si monsieur Shubert en question, dont Réhauna n’a d’ailleurs jamais entendu parler, était un compositeur américain. Ou un de ses amis de Regina qui se consacrerait à la musique à temps perdu.
Le visage de la vieille dame est transformé. Ce même monsieur Shubert est donc une sorte de dieu qu’elle vénère sans condition ? Réhauna a vu ce visage-là chez les quelques dévotes de Maria que Joséphine appelle les grenouilles de bénitier et qui sont transfigurées au moment de la sainte communion ou devant un sermon particulièrement virulent de leur gros curé. Sa tante Régina va-t-elle lui jouer de la musique d’église ? Au piano plutôt qu’à l’orgue ? Réhauna se carre dans son sofa . Après tout, mieux vaut de la musique d’église, même au piano, que ce silence insupportable qui pesait sur elles jusque-là.
Les minutes qui suivent sont d’une telle beauté que Réhauna reste rivée à son siège. Elle n’a jamais entendu un piano de sa vie, elle ne connaît rien à la musique – à part le petit orgue de l’église, il y a bien monsieur Fredette, à Maria, le violoneux de service qui sévit à tous les anniversaires et à tous les mariages, mais son instrument griche trop pour qu’on puisse appeler ça de la vraie musique et monsieur Fredette lui-même sent trop fort pour qu’on s’attarde à l’écouter de trop près -, mais ce que les doigts de sa grand-tante Régina produisent au contact des touches blanches et noires du clavier, ce bonheur presque insoutenable dont elle ne soupçonnait pas l’existence, cette force irrésistible qui la brasse tout en la caressant, la transporte de bonheur, elle qui pensait à se sauver en courant de cette maudite maison quelques minutes plus tôt tant elle était découragée. Qui aurait cru qu’autant de beauté se cachait chez la tante Régina, le paquet de nerfs que toute la famille redoute, la colérique qui n’accepte aucune contrariété, cette personne menue et de toute évidence fragile qui ignore tout des enfants ; qu’elle possédait l’un des plus grands secrets de l’univers ? Et qu’elle le garde caché ici, entre quatre murs, alors qu’elle devrait le partager avec tout le monde parce ue tout le monde en a besoin pour survivre ?
C’est donc ça la musique ? Ça peut être autre chose que les fausses notes de sœur Marie-Marthe, le dimanche matin, et le grincement insupportable de l’instrument de monsieur Fredette ? C’est donc vrai que ça peut être beau ?
Ça commence en douceur, on dirait une berceuse murmurée par une grand-mère qu’on adore, on dirait surtout qu’on connaît cet air-là depuis toujours – il semble familier dès la première fois u’on l’entend-, mais aussitôt que la musique est imprimée dans le cerveau et qu’on est convaincu qu’on ne pourra plus jamais s’en débarasser, au moment où on commencerait à souhaiter que ça reste comme ça, sans variantes, parce que c’est parfait, ça change de rythme, tout à coup, ça se développe, ça monte et ça descend comme quand on rit, ça gronde, aussi, ça menace et ça tire les larmes parce qu’un grand malheur se cache là-dedans autant qu’une immense joie, puis, tout aussi soudainement, ça redevient mélancolique et le si bel air du début fait un retour en force, plus magnifique que jamais dans sa grande retenue. C’est ça qu’on veut conserver, d’ailleurs, c’est ça qu’on veut transporter pour le reste de sa vie, ce petit air tout simple du début et de la fin qui va pouvoir vous soulager dans les moments difficiles de l’existence et décorer les moments de bonheur d’un ravissement de plus. Ça se termine pas, non plus, on dirait plutôt que ça s’efface, que ça s’estompe, jusqu’à ce qu’on ne l’entende plus. Ça continue, il faut que ça continue, ça ne peut pas s’arrêter, mais on ne l’entend plus, c’est tout. Les mains ne se promènent plus sur le clavier, aucune vibration ne surgit de l’instrument, et cependant ça se perpétue dans le silence qui succède.
Ça a duré combien de temps, cinq minutes, vingt ? Réhauna ne saurait le dire, tout ce qu’elle sait c’est qu’elle voudrait que ça ne s’arrête jamais. C’est ça, l’éternité.