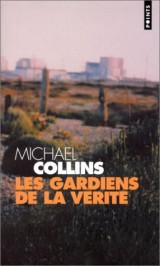Les gardiens de la vérité – Michael Collins
Les gardiens de la vérité – Michael Collins
J’appelle celui-ci « Ode à un directeur stagiaire ».
Quand vous entrerez dans notre ville, j’aimerais que vous lisiez ce qui suit, pour vous éclairer sur la façon dont ça se passe ici, avec nous, à ce moment de l’histoire. C’est vraiment la chose à faire. Même au Moyen Age ils mettaient des panneaux où on pouvait lire : « Peste ! Défense d’entrer ! »
Voilà ce que je dirais…
Nous n’avons rien fait dans cette ville depuis plus de dix ans. C’est comme si la peste s’était abattue sur nos hommes, tout aussi horrible que les dix plaies d’Égypte. Avant, nos hommes fabriquaient des voitures, des feuilles de métal, des caravanes, des machines à laver et des sèche-linge, des encadrements de porte, des poutrelles d’acier pour les ponts et les gratte-ciel. Notre ville avait dees contrats avec Sears, Ford et General Motors. Tout le monde travaillait dans une usine, on pliait le métal pour lui donner la forme d’ailes de voiture, de joints de culasse, de culasses, de têtes de Delco, et on cousait des sièges de vinyle pour des Cadillac et des Continental. Les mains nous démangeaient de faire quelque chose. Les usines étaient nos cathédrales, qui avaient poussé dans les Grandes Plaines.
Autrefois le vacarme, le grondement souterrain des machines emplissait notre conscience. Vous auriez ressenti le son répété des marteaux-pilons sous notre couche de neige quand l’hiver s’abattait et nous fermait au monde extérieur, transformant les choses tandis que la neige lourde tombait sur les plaines et nous isolait.Nos fourneaux saignaient dans la neige, un creuset de feu parmi les plaines. La paix régnait à l’époque, et la sécurité, on roulait tous sous les globes des lampadaires dans les rues labourées, on rentrait lentement chez nous en voiture, épuisés, tandis que les machines de notre existence avalaient l’équipe de nuit. Vous auriez vu le lent serpent des trains chargés des voitures luisantes que nous avions fabriquées partir vers les grandes villes des côtes Est et Ouest.
Si vous étiez venus nous rendre visite dans la chaleur brûlante de l’été, vous auriez vu nos hommes dans des T-shirts jaunes pleins de taches, ruisselants de sueur, qui mangeaient au bord de la rivière dans des gamelles en fer, et descendaient du Coca-Cola glacé et des seaux de bière fraîche. Vous auriez vu comment ils s’essuyaient la bouche de l’avant-bras, avec une grande satisfaction, avant de se lever, de s’étirer et de faire le tour des cours d’usine en tirant de longues bouffées de leur cigarette. Vous auriez peut-être entendu le bruit sec d’une batte de base-ball pendant la pause du déjeuner, nos hommes couraient d’une base à l’autre autour des terrains derrière les usines, et lançaient des balles au-delà du périmètre des grès brun de notre existence. Il y avait de la bière bon marché dans l’obscurité des bouges pour les hommes qui en avaient besoin, et tout un assortiment de putains dans le vaste labyrinthe des viaducs et des mares de refroidissement des fonderies. Nous avions aussi une fabrique de chocolat, dans laquelle nos jeunes femmes coiffées de toques de pâtissières collaient des caramels au lait sur des plaques de cuisson cirées. Vous les auriez rencontrées en train de fumer, accotées aux murs de grès noircis, de pâles fantômes couverts de farine. Elles avaient cette luxueuse odeur de cacao et de cannelle incrustée dans les pores de la peau.
Et par une chaude nuit d’été, vous nous auriez trouvés dans le destin collectif d’un drive-in en voiture dans l’air chaud et humide de l’été vous auriez entendu les cris perçants dans le réseau de l’horreur de vivre pendant la guerre froide, alors que des fourmis géantes nées d’un holocauste nucléaire attaquaient la ville de New-York.
Il y avait un mouvement permanent dans notre ville, dense et inépuisable, autonome, l’alimentation éternelle des fourneaux se poursuivait nuit et jour avec nous dans un isolement magnifique, les gardiens de l’industrie. Vous auriez pensé, comme nous, que les moyens de production ne cesseraient jamais de fonctionner, mais vous auriez eu tort.
Aujourd’hui, nos usines près de la rivière sont abandonnées, les fenêtres crevées, des touffes d’herbe poussent à travers les toits effondrés. Nous sommes en guerre contre nous-mêmes dans la plus grande calamité que notre nation ait jamais affrontée. Nous nous entre-tuons dans des échanges truqués, dans un marché noir de la drogue qui se déroule à l’ombre de nos cathédrales abandonnées. Nos adolescents se glissent parmi ces ruines, escaladent les clôtures fermées par des chaînes, arrachent les tuyaux de cuivre des usines, et les vendent. Des issues de secours rouillées conduisent à des escaliers qui vont vers l’oubli et les ténèbres. On traîne, dans les cours, des machines à l’allure préhistorique que l’on cannibalise de tout ce qui a de la valeur, carcasses de l’industrie. Nos filles écartent les jambes sur le plancher d’ateliers dans lesquels autrefois nos hommes martelaient de l’acier. Nous sommes encerclés par des champs de maïs, cernés par des récoltes dont la culture ne paie plus. La bourse de commerce a été liquidée. Il y a des montagnes de beurre et des montagnes de blé, des stocks de nourriture en train de pourrir, qu’il faut détruire à cause de la surproduction et de la chute des prix.
Nous sommes à présent une ville de directeurs stagiaires.Oh, heureux sommes-nous qui avons hérité de la friteuse ! Maintenant, nous mangeons. Cela est devenu notre unique occupation, nos mains oisives ont trouvé quelque chose à attraper. Nous attrapons surtout des hamburgers, dans une manifestation carnivore de désir sublimé pour nos machines mortes. Nous avons McDonald’s, Burger King, Arby’s, Hardee’s, Dairy Queen, Shakey’s, Big Boy, Ponderosa, Denny’s, International House of Pancakes…
Mais cela vous ne le lirez jamais sur des panneaux aux portes de notre ville.
Roman traduit de l’anglais ( États-Unis ) par Jean Guiloineau